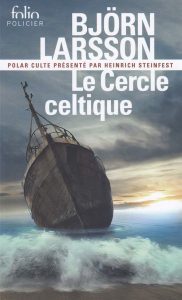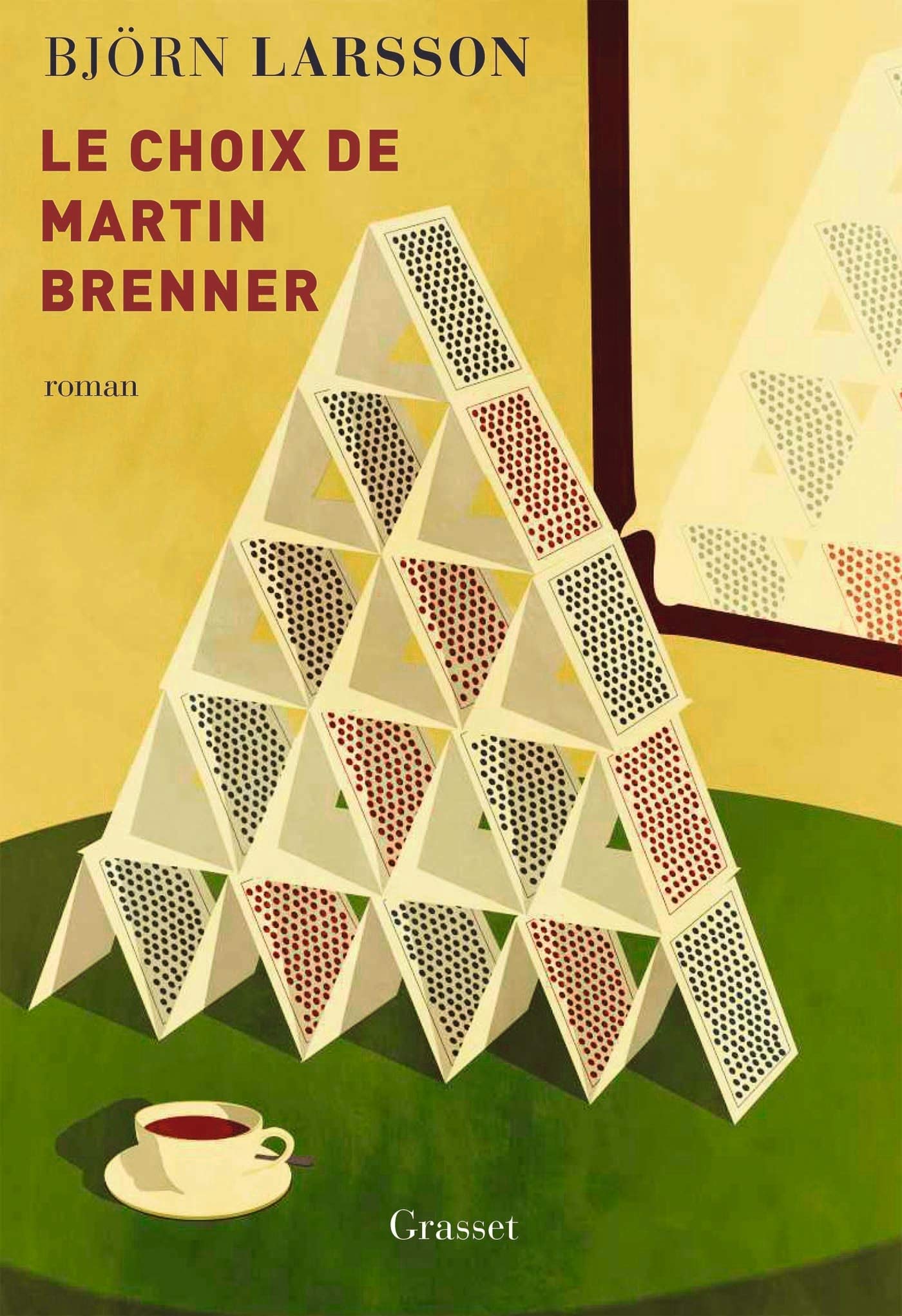Une interview du Nordic Reading Club avec l’auteur Björn LARSSON, à l’occasion de la sortie de son roman Le choix de Martin Brenner aux éditions Grasset.
Sophie PEUGNEZ : Bonjour Björn Larsson. Avant de nous plonger dans votre livre «Le choix de Martin Brenner», j’aimerai que l’on revienne sur votre parcours. Comment êtes-vous venu à l’écriture ?
Björn LARSSON : Je ne saurais le dire avec certitude, mais j’ai commencé timidement à écrire quand j’étais au lycée, après une année passée dans un high-school aux États-unis. En rentrant, quelque chose avait changé, ma passion pour la géologie et la plongée sous-marine s’est estompée, au moins comme études et avenir professionnel. Une chose est certaine, c’est que j’avais été beaucoup influencé par les livres d’écrivains, comme Hemingway, Simone de Beauvoir, Henry Miller et George Orwell, qui racontaient leur vie de bohèmes à Paris. Si je suis parti à Paris à 19 ans « pour écrire », c’était en grande partie par romantisme. Ce qui n’empêche pas que j’ai dû avoir l’impression d’avoir quelque chose sur le cœur à raconter qui pouvait intéresser d’autres que moi. En tout cas, je ne connaissais personne qui écrivait et personne dans ma famille même lointaine qui avait manié la plume, personne donc qui pouvait me conseiller ou m’encourager.
Le premier texte que j’ai publié dans une revue était une nouvelle basée sur mes expériences d’un mois de prison où j’ai fini pour avoir refusé mon service militaire. Après, encouragé, j’ai écrit d’autres nouvelles qui sont devenus un recueil qui, à ma grande surprise, a été publié.
Ensuite, j’ai écris encore et beaucoup pendant une dizaine d’années sans qu’il en sorte rien de potable. Jusqu’au moment où j’ai imaginé l’histoire du «Cercle celtique», et surtout le personnage de MacDuff, tiré de je ne sais où. C’est là où, selon moi, je suis devenu écrivain, ayant eu le courage de faire confiance à mon imagination (et, bien sûr, d’arriver à la caser sur papier, en noir et blanc, ce qui est le vrai travail de l’écrivain).
SP : Amoureux des langues vous en maîtrisez plusieurs. Qu’est-ce qui vous fascine dans l’apprentissage d’autres langues ?
BL : La réponse simple serait de dire que l’apprentissage des langues étrangères m’a ouvert des portes qui sinon seraient restées fermées, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle comme écrivain et comme universitaire. Déjà, il faut savoir que j’ai gagné ma vie – et même devenu professeur universitaire – avec le français, que j’ai commencé à étudier non pour faire carrière, mais pour vivre en France. Jamais je n’aurais pu écrire «Le cercle celtique» ou «Long John Silver», par exemple, sans savoir parler le français et l’anglais. Jamais je n’aurais pu profiter autant des invitations au festivals et rencontres avec mes lecteurs en Italie sans connaître l’italien, que j’ai appris exactement pour cette raison-là. Dans ma vie privée, j’ai connu des amours et formé des amitiés à toute épreuve que je n’aurais jamais eus sans le français, le danois, l’espagnol ou l’italien. J’ai un peu la réputation d’être un globetrotter, à tort, car j’ai toujours préféré vivre un peu à l’étranger, avec la langue en main, pour ne pas être un touriste observateur. Mais au-delà, sans savoir pourquoi, j’aime étudier les langues étrangères sans aucune autre motivation que le seul plaisir, en partie lié au fait de découvrir un autre monde, une autre culture, une autre littérature aussi, que je lis toujours en V.O. si je peux. En ce moment par exemple, ayant appris l’italien suffisamment bien pour ne pas risquer de le perdre, je me suis remis un peu à l’allemand.
SP : Vous êtes suédois et vous vivez une partie de l’année en Italie, est-ce que vous éprouvez un besoin d’ailleurs ou peut importe le lieu ce qui compte c est les gens qui vous entourent ?
BL : Ce qui compte le plus, c’est les gens. Mais le lieu, la culture, la langue, la beauté du paysage et même la gastronomie (y compris le vin) compte aussi. C’est comme si je me sens en affinité avec certains lieux et pays, plus que d’autres. Ni l’Angleterre ni l’Allemagne ne m’ont jamais attiré. Je pensais que l’Espagne, où j’ai un peu vécu jeune et navigué plus tard, serait mon deuxième pays adoptif après la France, mais je n’ai jamais accroché. J’ai vécu quinze ans au Danemark sans que ce soit devenu «mon pays» et sans que j’aie vraiment appris la langue. Pour moi, l’idéal serait un mélange d’Écosse, de France (surtout la Bretagne) et d’Italie, avec quelques grains d’Irlande et de la Suède.
SP : Vous avez vécu sur un bateau, élément très important dans vos romans : «Le cercle celtique», «Les poètes morts n’écrivent pas de romans policiers», « Long John Silver»… Est-ce un lieu privilégié pour pouvoir vous concentrer et écrire ?
BL : Cela l’a toujours été, un peu moins maintenant que je ne vis plus sur le bateau, sauf en été. L’avantage d’écrire sur le bateau est qu’il y a moins de distractions, sauf les mouettes. Le désavantage est qu’il manque d’espace pour s’entourer des livres dont on a besoin (l’ebook n’est pas pour moi), dont les dictionnaires.
Cependant, cela serait une erreur de penser qu’il «faut» vivre sur un bateau pour raconter la mer. Joseph Conrad, par exemple, a écrit tous ses grands romans maritimes à terre, après avoir débarqué. Patrick O’Brian, lui, n’avait jamais mis les pieds sur un bateau, pas plus que Hugo, d’ailleurs, pour écrire «Les travailleurs de la mer».
SP : «Le choix de Martin Brenner» est un texte dense et riche, quelle a été sa genèse ?
BL : Il y a plus de quinze ans a été semé le premier grain de mon dernier roman, «Le choix de Martin Brenner», même s’il a fallu attendre encore dix ans avant que le grain a commencé à germer sur les pages d’un de mes cahiers.
Cela s’est passé à Vancouver, au Canada, où j’étais l’invité de Peter Stenberg, professeur des langues scandinaves. Lorsque Peter a appris que ma mère avait repris le nom de jeune fille de sa grand-mère, qui était Zander, il m’a tout de suite demandé si ce n’était pas là un nom juif. J’ai répondu que je n’en savais rien ; personne dans ma famille, même pas ma mère, ne savait rien de cette grand-mère. Peter, en fait, était en train de compiler une anthologie des écrivains juifs suédois et « voulait » que je sois juif pour pouvoir inclure dans son anthologie quelques pages de mon roman Long John Silver, qu’il avait beaucoup aimé !
Un peu de temps après, j’ai parlé avec ma tante paternelle, qui m’a raconté que nous avions « du sang wallon dans les veines », ce qui expliquerait la couleur marron de nos yeux et des cheveux. Quelque temps après, j’avais appris dans un essai sur les gens du voyage en Suède, que beaucoup d’entre-eux se disaient « wallons » pour échapper aux persécutions dans les années cinquante.
Je ne pouvais donc pas exclure que j’avais des origines juives du côté de ma mère et des origines roms du côté de mon père. Cela est vite devenu une question dans ma tête: et si cela se vérifiait, qu’est-ce que cela changerait pour moi ? Ou, encore un plus tard, pour Martin Brenner, cinquantenaire, marié et père d’une fille, qui découvre à la mort de sa mère qu’elle n’était pas celle qu’il avait toujours cru, une rescapée des bombardements de Dresden, mais juive et survivante d’Auschwitz, ce qu’elle avait toujours caché à son fils, de peur que l’histoire se répète ?
Martin se retrouve donc dans la situation exceptionnelle qu’il peut choisir d’être juif ou non. S’il ne dit rien à personne, il ne sera pas juif, mais devra payer le prix d’avoir un secret pour ses proches et amis, comme l’avait eu sa mère pour son fils. Si, en revanche, Martin accepte d’être juif, personne ne s’y opposera, ni les Juifs, ni les antisémites qui, eux, auront encore un juif à haïr. La troisième option, qui serait de reconnaître publiquement que la mère était juive, mais que lui ne l’était pas, et surtout ne voulait pas le devenir, n’aurait l’approbation de quasiment personne. C’était là la position adoptée par Hannah Arendt quand elle affirmait ne pouvoir aimer – ou haïr – aucun « peuple », que ce soit le peuple juif, américain, français ou prolétaire, ce dont elle s’est fait violemment reprendre, y compris par ses « amis » juifs. Le dilemme initial posé et le personnage principal en place, le roman pourrait sembler bien parti. Mais c’est là où commençait le vrai travail, c’est-à-dire d’imaginer la trame d’une histoire et des personnages qui pouvaient incarner le thème profond du roman.
En effet, «Le choix de Martin Brenner» n’est pas un roman seulement sur l’identité juive, mais sur plusieurs questions existentielles et idéologiques associées à la recherche effrénée d’identité – que celle-ci soit religieuse, culturelle, ethnique, nationale ou sexuelle – qui caractérise l’époque actuelle, au détriment de l’humain: la peur et la haine de l’autre, le poids du passé par rapport au devenir, le besoin ou le refus d’appartenance, la généralisation abusive des gens en catégories et tant d’autres.
SP : Sans vouloir spoiler le récit, il y a une structure particulière est-ce que cela a été une évidence ou est-ce qu’il vous a fallu plusieurs mois de réflexion ? A-t-il été écrit d’un seul jet ou est-ce que vous l’avez repris plusieurs fois en faisant des coupures ?
BL : L’écriture du roman ne s’est absolument pas fait d’un jet; au contraire, il m’a fallu des années de lectures et de réflexions, plus l’écriture, pour en arriver au bout. Il fallait tout ce temps et toutes ces lectures, car n’étant pas juif, je devais savoir autant qu’eux, voire plus, pour me permettre de traiter un sujet aussi controversé et délicat que l’identité juive. J’avais décidé assez tôt, cependant (si je me rappelle bien) que la structure narrative devait réfléchir l’évolution du personnage principal. C’est pourquoi, dans la première partie, où Martin est toujours maître de son identité, tout est raconté de son point de vue alors que dans la deuxième le lecteur saura aussi ce que les autres personnages pensent de lui (sans révéler ce qui arrive avec la structure dans la troisième). D’ailleurs, il y aussi une autre particularité du récit, peut-être unique, à savoir qu’il n’est pas situé géographiquement dans la partie de Martin. L’idée était que je ne voulais pas que le lecteur puisse se dire que si, des histoires comme ça arrivent peut-être ailleurs, mais pas «chez nous».
SP : Il y a une bibliographie très riche à la fin de l’ouvrage. Vous avez dû lire énormément. Ce texte a nécessité combien d’années en comptant les recherches et la rédaction ?
BL : Je dirais cinq ans, au moins. Mais derrière, il y a eu aussi d’autres lectures et réflexions, notamment une étude sur les romans qui racontent l’Holocauste, d’ailleurs écrite en anglais et publiée dans une anthologie sur les dictatures de masse. Il faut dire que j’ai en partie traité des thèmes similaires dans d’autres romans, l’identité aussi bien dans «Le cercle celtique» que dans «Le mauvais œil», par exemple. La lutte pour défendre sa propre intégrité dans «La véritable histoire d’Inga Andersson».
SP : Au décès de sa mère, Martin Brenner va recevoir un héritage très particulier : il va apprendre que sa mère s’appelait Gertrud et non Maria et que c’est une survivante d’Auschwitz et elle lui laisse le choix de la judaïcité. Pensez-vous que l’on puisse se construire sans véritablement connaître ses racines ?
BL : Absolument. Non seulement on peut, mais des millions d’enfants orphelins laissés pour compte dans le monde n’ont pas d’autre choix que de s’inventer une vie et une identité. Une autre chose est la question de savoir si on peut choisir de se couper les racines qu’on a déjà. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’on peut – et devrait – toujours se demander ce qui vaut la peine d’être gardé ou ce qui mérite d’être délaissé des choses dont on a héritées. On dit souvent, encore plus aujourd’hui avec la mode des analyses génétiques des origines, qu’il «faut savoir d’où on vient, pour savoir qui on est». Mais pourquoi ne pose-t-on pas plus souvent la question de savoir où l’on veut aller, qui on voudra devenir ? Si on regarde trop dans le rétroviseur, on peut être à peu près sûr de se faire casser la gueule et pire tôt ou tard. On dit aussi, un autre cliché, qu’il « faut connaître l’histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé ». Mais quelles sont ces «erreurs», plus précisément ? Si nous ne savons pas où nous voudrons aller, connaître l’histoire ne sert pas à grand-chose.
SP : Martin Brenner fait des choix en pensant parfois à sa fille et en même temps il semble habité par une honnêteté intellectuelle. Ce sont des thèmes proches de la tragédie grecque, qu’en pensez-vous ?
BL : Dans un sens, oui. Car comme dans la tragédie, et pas seulement la tragédie grecque, les malheurs et les épreuves de Martin arrivent sans que ce soit sa faute.
SP : C’est un texte magnifique et en même temps douloureux sur la transmission notamment filiale, c’est un sujet qui vous tient à cœur ?
BL : Oui et non. J’ai la chance d’avoir une fille – et d’ailleurs un petit-enfant depuis trois mois – qui n’est pas seulement ma fille, mais aussi une belle personne en général. Mais cela n’est pas le cas de tout le monde. Quand une famille fonctionne bien, avec amour, amitié et solidarité, c’est évidemment une très belle chose. Mais quand la famille déraille, c’est plutôt l’enfer. Je me refuse donc d’idéaliser la famille ou la transmission filiale en général. Juste un exemple: ma mère, qui est dans une maison de repos, m’a raconté que lorsque les enfants viennent voir leurs vieux parents, c’est souvent pour demander de l’argent!
SP : Selon vous, la société d’aujourd’hui nous permet-elle le libre arbitre ?
BL : Cela dépend entièrement dans quelle «société» on vit et à quoi on veut utiliser son libre arbitre. Par exemple, une femme en Suède, surtout ayant des enfants, a beaucoup plus de libertés de choisir comment vivre sa vie qu’une femme en Italie, par exemple, pour ne pas parler de l’Arabie saoudite. Il reste que la liberté n’a de sens que par rapport à d’autres êtres humains, en société ou en groupes plus restreints. Comme je l’avais dit dans « Besoin de liberté », on ne naît pas libre, on le devient, éventuellement.
SP : Votre personnage Martin Brenner est pris comme dans une spirale, aviez-vous envie de peindre ce mécanisme (de l’expliquer) et en même dénoncer la haine qui peut s’abattre sur un individu (notamment via la presse et les réseaux sociaux) ?
BL : Ce n’était pas une motivation de départ, je crois. C’était plutôt la conséquence de sa découverte initiale, de sa personnalité, de ses convictions de base et de la situation professionnelle et privée dans laquelle il devait vivre et résoudre son dilemme. Mais il y eu aussi un autre roman, «L’honneur perdu de Katharina Blum», qui m’avait beaucoup frappé à l’époque où je l’avais lu et qui m’a sans doute influencé aussi.
SP : Est-ce que vous arrivez à avoir du recul par rapport aux personnages ou est-ce que vous avez comme habité en écrivant le récit ?
BL : Le rapport entre l’écrivain et ses personnages est toujours ambigu. D’un côté, on peut faire d’eux ce qu’on veut, plus ou moins, dans les limites de la vraisemblance. D’un autre, une fois créés, ils existent, et sont même plus vivants que beaucoup de personnes réelles qu’on connaît seulement d’ouï-dire ou de loin. Le fait est que je pense assez souvent à mes personnages, avec sympathie ou nostalgie dans certains cas, avec refus et rejet dans d’autres (il ne faut pas oublier qu’il y a également dans mes livres des personnages antipathiques). Saviez-vous que Maurice Leblanc, le créateur d’Arsène Lupin, avait demandé vers la fin de sa vie qu’un gendarme soit posté devant sa maison. Il avait peur… d’Arsène Lupin !
SP : Comment trouver l’équilibre entre la transmission et le «pathos» lorsqu’on écrit sur un tel sujet ?
BL : Surtout en évitant que le narrateur donne des points aux personnages en termes de bon ou méchant. Dans «Le mauvais œil », par exemple, j’ai mis en scène aussi bien un terroriste islamiste qu’un raciste membre du Front national, mais sans les juger. Il fallait qu’ils soient «vrais» comme ils pouvaient l’être dans la vie réelle.
SP : Comment sort-on d’un tel texte ? Vous aviez besoin d’écrire autre chose ou avez-vous un besoin d’une grande respiration avec des jours en mer ?
BL : Il faut savoir que quand un livre comme celui-ci est publié, l’auteur, c’est-à-dire moi, en est déjà sorti bien avant. Mais il est vrai que ce roman m’a demandé un effort parfois surhumain, dépassant ce que j’avais vécu avec d’autres (sauf, en partie, « La véritable histoire d’Inga Andersson »). Ma solution à moi a toujours été de commencer à écrire autre chose le plus vite possible après avoir mis le mot fin à un livre précédent, en attendant qu’arrive ce que j’appelle l’urgence existentielle de mettre une autre question ou problème en histoire.
SP : Dans un article, vous parlez de l’envie de vivre dans la maison de Montalbano. Qu’est-ce qui vous fait rêver dans ce lieu ?
BL : C’était sans doute parce que l’interview était faite dans un contexte sicilien… Mais c’est vrai que la maison de Montalbano est belle, au bord de la mer, où on peut prendre un bain le matin après le déjeuner – ou avant – presque toute l’année. Mais j’ai rêvé d’autres maisons aussi, en Écosse ou en Bretagne par exemple. J’ai toujours fini par me dire que je pouvais toujours prendre le bateau et y vivre, si vraiment je le voulais, avec l’avantage de pouvoir repartir.
SP : Vous avez évoqué le fait que vous aviez encore énormément d’articles et d’ouvrages à écrire or avec la soixantaine, vous êtes obligé de faire des choix. Quels sont les choix de Björn Larsson ?
BL : Je ne voudrais pas dire «grâce à» la pandémie, mais au moins à cause du virus, j’ai eu beaucoup de temps à moi cette dernière année. J’ai donc pu aussi beaucoup écrire et finir des petits projets qui traînait dans mes casier depuis longtemps : un récit sur le père que je n’ai pas eu (qui sera publié en Italie ce printemps, «Nel nome del figlio» ), un autre sur ma vie de faire aller et retour (je n’ai jamais habité près de mon travail) et l’étude que j’ai déjà mentionné sur les romans de l’Holocauste, écrit celui-là directement en français (mais sans éditeur pour le moment). En ce moment, je suis en train d’écrire un livre de science et de philosophie sur l’être humain, pas plus pas moins, qui est un peu la somme des réflexions et des lectures de toute une vie. Le titre : «The story of the human and not so human being» (eh oui, je l’écris en anglais). En revanche, je n’ai pas commencé de nouveau roman. Quand la réalité est aussi oppressante qu’aujourd’hui, il est difficile de faire de la fiction.
SP : Merci Björn Larsson d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Cette interview a été réalisée, pour le Nordic Reading Club, en partenariat avec le Festival Les Boréales. Nous aurions dû nous retrouver (Björn Larsson et moi avons fait connaissance à l’occasion d’un diner en Nord organisé par le Festival Les Boréales en 2014) dans le cadre des Nordic Days en novembre 2020 mais la pandémie en a décidé autrement. Souhaitons que les retrouvailles avec le public puissent avoir lieu en novembre 2021 dans le cadre de la 29° édition du Festival.